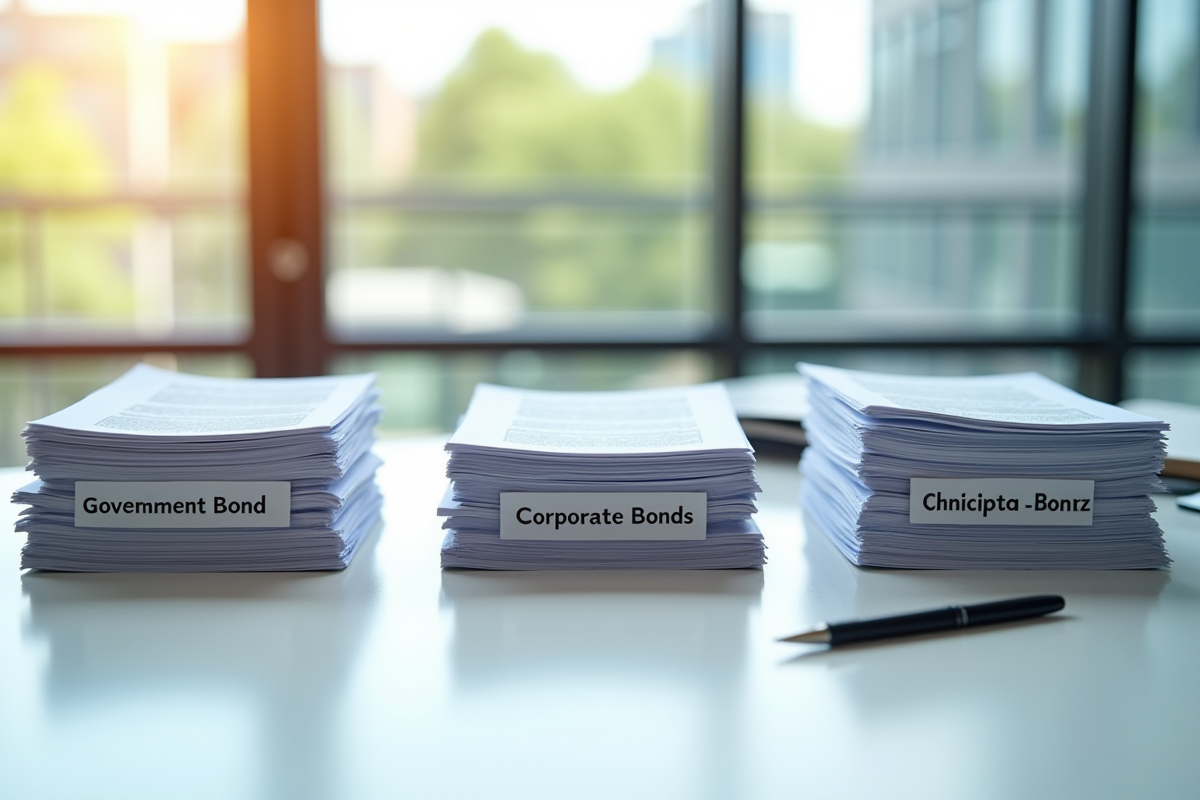3,4 millions de salariés français n’ont reçu aucune formation en 2022. Ce chiffre n’est pas tombé d’un rapport oublié : il traduit une réalité têtue, qui met l’employeur face à ses responsabilités. Car, refuser une formation à un collaborateur, ce n’est pas un simple arbitrage RH. C’est un acte lourd de conséquences, scruté par la loi et la jurisprudence.
Le droit à la formation s’impose aujourd’hui comme un socle indiscutable pour tout salarié, inscrit noir sur blanc dans le Code du travail. Les tribunaux, eux, ne laissent aucune place à l’arbitraire. Un refus non fondé, ou une différence de traitement, et la machine judiciaire s’emballe : discrimination, défaut d’adaptation, voire manquement à l’obligation de sécurité… l’employeur s’expose à bien plus qu’un simple rappel à l’ordre.
Comprendre le cadre légal de la formation professionnelle en entreprise
La formation professionnelle ne relève plus d’une faveur accordée au gré des envies managériales. Le Code du travail encadre strictement les devoirs de l’employeur en matière de formation des salariés. Dès l’embauche, le contrat de travail ouvre l’accès au plan de développement des compétences. Ce socle légal s’appuie notamment sur la loi « Avenir professionnel » du 5 septembre 2018, qui a bouleversé les règles du financement de la formation professionnelle et donné un nouveau souffle au Compte personnel de formation (CPF).
L’article L. 6321-1 du Code du travail impose à chaque entreprise d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste et de veiller à la pérennité de leur employabilité. Impossible d’y échapper, quel que soit l’effectif de la structure : la contribution à la formation professionnelle est universelle. Les Opco, ces organismes paritaires, soutiennent les entreprises pour financer et bâtir leurs plans de formation.
Ce paysage évolue en permanence. Le CPF ouvre la voie à une autonomie nouvelle, la validation des acquis de l’expérience (VAE) offre un pont vers la reconnaissance des compétences. Pour l’employeur, le plan de développement des compétences n’est pas une option : il répond à la fois à la loi et à la stratégie d’entreprise.
Voici les règles à garder en tête pour ne pas s’égarer :
- Chaque refus doit être justifié, écrit et archivé : la transparence protège.
- Le CSE ne doit jamais être ignoré : il a voix au chapitre sur la politique de formation professionnelle.
- L’entretien professionnel, mené tous les deux ans, est l’occasion de faire le point sur les besoins et le parcours de chaque salarié.
Mieux vaut ne pas jouer avec le feu : un refus sans motif valable ou en contradiction avec le plan de développement peut vite se transformer en contentieux. Les évolutions récentes rappellent l’intérêt d’une gestion collective et concertée de la formation, au service de la progression de chacun.
Refus de formation : quelles situations et quels droits pour le salarié ?
Un refus de formation ne se limite jamais à un simple « non » entre un employeur et un salarié. Plusieurs situations balisent la vie professionnelle, chacune avec ses propres règles. La loi fait la différence entre les formations obligatoires (sécurité, adaptation au poste de travail, maintien de l’employabilité) et les autres actions de développement des compétences. Impossible pour un employeur de refuser une demande qui relève de la sécurité ou de l’adaptation au poste sans assumer ses responsabilités. Dans ces cas, chaque décision doit être motivée et argumentée.
Dans d’autres circonstances, il est possible pour l’entreprise de justifier un refus. Voici les motifs qui peuvent être retenus :
- Cas de surcharge d’activité temporaire ou imprévue
- Formation demandée sans lien tangible avec le parcours professionnel du salarié
- Absence de pertinence par rapport à l’exécution du contrat de travail
Mais attention : la décision ne doit jamais être brutale. Elle s’accompagne d’une explication écrite et, surtout, d’un échange direct avec l’intéressé. L’entretien professionnel est souvent le cadre idéal pour en discuter, envisager d’autres pistes ou reporter la demande à une échéance plus adaptée.
Le salarié, de son côté, n’est pas démuni. Plusieurs recours s’offrent à lui : solliciter les représentants du personnel, saisir le Conseil de prud’hommes ou demander une médiation interne. L’égalité d’accès à la formation et la transparence des critères sont ses meilleurs alliés. Toute décision qui freine l’évolution ou déséquilibre un parcours peut être contestée.
Comment l’employeur peut-il gérer un refus sans risquer de litige ?
Pour un employeur, refuser une formation n’est jamais anodin. Chaque décision doit s’inscrire dans le cadre imposé par le Code du travail et être le fruit d’une réflexion argumentée. Un refus non justifié, et c’est la porte ouverte au litige devant le Conseil de prud’hommes avec, à la clé, des dommages et intérêts potentiels.
La clé ? Tout consigner. La réponse au salarié doit être précise, motivée et adaptée à la réalité de son poste et de son parcours. Montrer que la demande a été étudiée sérieusement, en lien avec l’évolution des métiers et des outils, c’est limiter les risques d’être accusé d’arbitraire.
Points de vigilance pour l’employeur
Pour éviter tout faux pas, voici les pratiques à adopter :
- Respect strict du droit : refuser une formation obligatoire (sécurité, adaptation au poste) peut être assimilé à une faute grave et justifier un licenciement.
- Traçabilité sans faille : conservez tous les échanges, décisions et justificatifs, surtout lors des entretiens professionnels.
- Proposer des alternatives, dans la mesure du possible, conciliant contraintes de service et besoins du salarié.
Le dialogue ouvert reste l’arme la plus efficace contre l’escalade. Prendre le temps d’exposer les raisons, d’écouter les attentes et de rappeler la logique collective, c’est préserver la confiance et la motivation, sans sacrifier la cohésion de l’équipe.
Conseils pratiques pour instaurer un dialogue constructif autour de la formation
Un refus de formation n’est jamais un simple affrontement. Le contexte, la réalité de l’entreprise et les aspirations individuelles s’entrecroisent. Pour bâtir un climat de confiance, l’écoute active doit primer lors de l’entretien professionnel. Ce rendez-vous, distinct de l’entretien annuel, permet de clarifier les besoins, lever les obstacles et ouvrir la voie à un véritable dialogue sur le développement des compétences.
Le CSE (comité social et économique) peut jouer un rôle décisif dans ces situations. En sollicitant cet espace de discussion, on facilite l’émergence d’un avis partagé et la remontée de propositions concrètes au niveau collectif.
La communication doit rester limpide. Exposez sans détour les raisons du refus, qu’elles tiennent à l’organisation, à la stratégie ou à des contraintes ponctuelles. Quand cela s’y prête, proposez des alternatives : réaménager le calendrier, envisager d’autres formats d’apprentissage, reporter la formation. Cette souplesse montre l’intérêt porté au parcours de chaque collaborateur.
Valoriser la formation comme levier d’évolution, c’est aussi rappeler le contexte national où les dispositifs comme le CPF et la VAE se renforcent. Entretiens, échanges et initiatives collectives nourrissent à la fois les ambitions individuelles et l’attractivité de l’entreprise. L’équilibre se construit ainsi, pas à pas, dans la confiance retrouvée et le dialogue continu.